Évolution, créationnisme et sciences – avancé – 4
Leçon 4 : le fondamentalisme scientifique
et la nature de la science
Dans cette leçon, nous allons porter notre attention sur un aspect souvent ignoré de la controverse évolution création: l’attitude parfois élitiste que les scientifiques et les éducateurs en matières scientifiques affichent et qui est partiellement à blâmer pour le peu de respect et de compréhension que la communauté scientifique semble avoir vis à vis le public en général. En d’autres termes, après avoir examiné pourquoi le créationnisme est une absurdité, nous devons équilibrer les choses et voir ce que c’est que les scientifiques font mal. Puis, dans la leçon finale de ce module, nous examinerons ensuite quelques pistes de solutions qui pourraient améliorer la situation dans un avenir prévisible.
Commençons par un exemple. Edward Teller (1908 -2003) est considéré comme le père de la bombe à hydrogène. Bien qu’il y ait lieu de se questionner sur  quelle part de sa contribution au développement de cette arme était vraiment originale ou cruciale, le fait demeure que toute sa carrière scientifique a été associé à cette entreprise en particulier. Étant donné que nous parlons d’une arme de destruction massive qui pourrait bien anéantir toute vie tel que nous la connaissons sur la planète Terre, On pourrait s’attendre à ce que Teller se soit dissocié de tout l’épisode et aurait même activement promu une discussion critique sur le rôle de l’éthique et de la science et du rôle des scientifiques dans la société moderne, comme Einstein et Oppenheimer l’ont fait. Vous seriez très déçu. Non seulement Teller n’a-t-il jamais exprimé l’ombre d’un regret d’avoir engendré cet engin apocalyptique qu’est la bombe, mais il était extrêmement fier de lui.
quelle part de sa contribution au développement de cette arme était vraiment originale ou cruciale, le fait demeure que toute sa carrière scientifique a été associé à cette entreprise en particulier. Étant donné que nous parlons d’une arme de destruction massive qui pourrait bien anéantir toute vie tel que nous la connaissons sur la planète Terre, On pourrait s’attendre à ce que Teller se soit dissocié de tout l’épisode et aurait même activement promu une discussion critique sur le rôle de l’éthique et de la science et du rôle des scientifiques dans la société moderne, comme Einstein et Oppenheimer l’ont fait. Vous seriez très déçu. Non seulement Teller n’a-t-il jamais exprimé l’ombre d’un regret d’avoir engendré cet engin apocalyptique qu’est la bombe, mais il était extrêmement fier de lui.
En effet, il était tellement convaincu que la science ne peut pas faire de mal qu’il a proposé au fil des ans toute une série ridicule d’usages « pacifique » des applications de la bombe H, comme de trouver la composition chimique de la lune par l’explosion d’une bombe sur sa surface, de permettre de niveler des montagnes pour faciliter la construction de routes, au dragage de ports et de canaux, de tester la théorie de la relativité en faisant exploser une bombe de l’autre côté du soleil. Peut-être les suggestions de Teller peuvent être charitablement interprétées comme la tentative désespérée d’un homme pour justifier le travail de sa vie malgré les conséquences évidentes que cela pourrait comporter pour l’humanité. Néanmoins, il est difficile de trouver un exemple plus clair et inquiétant de scientisme , la croyance fondamentale que la science ne peut rien faire de mal et finira par répondre à toutes questions que l’on peut se poser, et en prime s’avèrera le sauveur de l’humanité.
Le scientisme
Des exemples plus bénins de scientisme sont illustrés par des scientifiques de premier plan comme le biologiste E.O. Wilson et le physicien Steven Weinberg. Curieusement, Wilson et Weinberg s’expriment sur ce qu’ils considèrent comme étant l’inutilité de la philosophie, quoique dans des perspectives différentes.
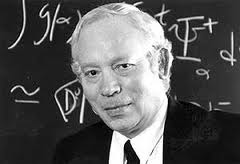 Pour Weinberg, la pensée philosophique est une perte de temps et est fait préjudiciable à la vraie science. Son argument est que non seulement les philosophes n’accomplissent jamais rien, mais surtout qu’ils n’ont jamais contribué à résoudre aucun problème scientifique. De plus, dans certains cas, les positions philosophiques de plusieurs scientifiques ont entravé les progrès de façon significative. Par exemple, Weinberg soutient qu’une école de pensée philosophique connue sous le nom de positivisme logique, qui a été particulièrement populaire au début du XXe siècle, a considérablement ralenti l’acceptation de la mécanique quantique en raison de son rejet du « non-observable » (c’est-à-dire ce qui ne peut pas être mesurées directement) comme étant scientifiquement valable. La mécanique quantique est sans doute la théorie scientifique s’appuyant sur le plus grand nombre de facteurs non observables et pourtant elle a fait la démonstration d’une si grande précision dans ses prédictions et ses explications d’une variété de phénomènes naturels que peu remettent en doute sérieusement sa validité.
Pour Weinberg, la pensée philosophique est une perte de temps et est fait préjudiciable à la vraie science. Son argument est que non seulement les philosophes n’accomplissent jamais rien, mais surtout qu’ils n’ont jamais contribué à résoudre aucun problème scientifique. De plus, dans certains cas, les positions philosophiques de plusieurs scientifiques ont entravé les progrès de façon significative. Par exemple, Weinberg soutient qu’une école de pensée philosophique connue sous le nom de positivisme logique, qui a été particulièrement populaire au début du XXe siècle, a considérablement ralenti l’acceptation de la mécanique quantique en raison de son rejet du « non-observable » (c’est-à-dire ce qui ne peut pas être mesurées directement) comme étant scientifiquement valable. La mécanique quantique est sans doute la théorie scientifique s’appuyant sur le plus grand nombre de facteurs non observables et pourtant elle a fait la démonstration d’une si grande précision dans ses prédictions et ses explications d’une variété de phénomènes naturels que peu remettent en doute sérieusement sa validité.
Weinberg a peut-être un bon argument dans le cas du positivisme logique (une position, d’ailleurs, que bien peu de philosophes épousent aujourd’hui, tout comme il est difficile de trouver des « newtoniens » parmi les physiciens ou des « lamarckiens » parmi les biologistes). Par contre, là ou il est complètement hors piste et démontre son scientisme est dans sa méconnaissance du rôle de la philosophie.
Le rôle de la philosophie n’est pas de « résoudre» les problèmes de la même manière que le fait la science et ne cherche certainement pas à résoudre des problèmes scientifiques. Le rôle du philosophe, du moins dans la compréhension moderne du terme, est d’être un méta-penseur, de réfléchir à la façon dont nous parvenons à certaines conclusions et par quels moyens nous avançons dans nos recherches (épistémologie), ainsi que de s’étendre sur la relation entre ce que nous faisons et ce que nous devrions faire (éthique) et sur notre vue globale de la réalité (métaphysique).
Bien que toutes ces activités philosophiques doivent être nourries par la science (sinon le philosophe se condamne à un exercice stérile d’une logique coupée du monde réel), ce ne sont pas des activités scientifiques et leur efficacité ne peut être jugée selon des normes scientifiques. C’est précisément cette obsession de l’application des normes scientifiques pour tout ce qui existe qui caractérise le scientisme .
Le scientisme de Wilson est différent de celui de Weinberg mais, je crois, tout aussi erronée. Dans son livre « Consilience: l’unité du savoir », Wilson établit un  programme ambitieux pour la science. Il explique qu’il n’y a qu’un seul type de connaissances et que finalement tous les domaines, de la philosophie à la science, des sciences sociales à l’art et même la religion, vont finir par converger sur les mêmes réponses.
programme ambitieux pour la science. Il explique qu’il n’y a qu’un seul type de connaissances et que finalement tous les domaines, de la philosophie à la science, des sciences sociales à l’art et même la religion, vont finir par converger sur les mêmes réponses.
Cela semble beaucoup plus inclusif que la «scientisation» de tout de Weinberg, mais la différence n’est que superficielle. Au début de l’ouvrage de Wilson il appert clairement que ce qu’il entend par l’unification de la connaissance est, en fait, une réduction de tout le reste à la science. Il voit un avenir dans lequel les sciences sociales, la religion, l’art et la philosophie seront toutes expliqués par et donc réduit à, la science. Il s’agit d’une forme d’orgueil contre laquelle les anciens philosophes grecs nous avaient déjà mis en garde il y a 25 siècles.
Bien sûr, personne ne songe à se déclarer un adepte du scientisme (en fait, le terme n’a pas de mot associatif pour décrire une telle personne: les scientifiques sont ceux qui font de la science et non ceux qui adhèrent à l’idéologie du scientisme ). En effet, en philosophie, c’est devenu un sport répandu d’accuser l’adversaire de scientisme de ridiculiser sa « foi » dans les sciences et par conséquent tenter de réduire les différends philosophiques comme étant d’ordre scientifique.
Les créationnistes, aussi se targuent de respecter la science, affirmant que c’est le scientisme qu’ils détestent, bien qu’ils définissent « la vraie science » comme étant tout ce qui ne contredit pas leur interprétation de la Bible et comme « scientiste» toute position qui n’est pas en accord avec les leurs. Le scientisme et les sentiments anti science sont les deux côtés d’une même médaille, un engagement aveugle envers une idéologie particulière, advienne que pourra.
Qu’est-ce que la science?
Maintenant que nous avons une appréciation de la position scientiste et un sens intuitif de la raison pour laquelle elle peut réellement porter ombrage à la vraie science, il serait instructif de comprendre ce qu’est la science moderne et comment elle fonctionne. Nous pouvons commencer par dissiper un mythe commun. La science n’est pas un ensemble de connaissances. L’ensemble de connaissances acquises que nous appelons « scientifique» est un produit de la science, mais ne la définie pas.
Par exemple, la théorie de la relativité générale est maintenant presque universellement acceptée comme la meilleure explication de beaucoup (mais pas la totalité) des propriétés physiques de base de l’univers. Elle a entièrement supplanté la physique (classique) de Newton comme modèle pour comprendre le monde. Est-ce à dire que la mécanique newtonienne était de la science, mais qu’elle ne l’est plus depuis Albert Einstein? Bien sûr que non. Les deux théories ont été développées dans le domaine de la science en utilisant des méthodes scientifiques. Les deux sont valables avec certaines limites, mais la théorie d’Einstein est d’application beaucoup plus large et elle fait des prédictions plus précises. Par conséquent, elle nous donne une explication plus complète de ce qui existe. Ceci (et le fait que la mécanique newtonienne est conceptuellement plus simple) est la raison pourquoi on enseigne aux étudiants en physique la mécanique classique au début de leur carrière universitaire, pour ensuite leur dire de l’oublier quand ils sont initiés aux merveilles de la relativité.
Donc, la science est une méthode utilisée pour découvrir et expliquer provisoirement les observations sur le monde qui nous entoure, ainsi que de prédire les observations futures. Je vais expliquer brièvement les principes fondamentaux, ce qui est souvent négligé, de ce qu’on entend par le terme provisoire inséré dans cette définition. Pour l’instant, contentons-nous de la distinction entre la science comme méthode et l’ensemble de la connaissance scientifique qui est le résultat de l’application de cette méthode.
Mais quelle est la méthode par laquelle la science fonctionne? Dire que les scientifiques découvrent des choses et expliquent les phénomènes de manière scientifique se réduit à rien de plus que de mettre une étiquette sur une boîte mystérieuse. Lorsque la boîte est ouverte, cependant, il est clair pour tout le monde que la science est, fondamentalement, une approche très simple et directe à la réalité, même si certaines de ses conclusions se révèlent complètement contre-intuitives.
Les philosophes des sciences ont eu du mal à définir la méthode scientifique. En effet, on chuchote que les scientifiques eux-mêmes entrent en terrain miné lorsqu’on leur demande de définir de quelle façon la science fonctionne réellement. Il y a une explication simple à ces hésitations, certaines choses s’apprennent mieux par la pratique. Les philosophes eux-mêmes ne pratiquent pas la science et donc leurs conclusions à ce sujet se fait par méthode d’observations indirectes, de discussions et de lectures sur la façon dont la science se fait. C’est comme essayé de comprendre la méthodologie d’un mécanicien automobile par la lecture d’un manuel de réparation.
Les scientifiques ont souvent du mal à définir précisément ce qui pour eux est devenu un automatisme par le résultat d’années de formation et d’expériences. Pensez combien il est difficile d’expliquer en termes clairs une chose simple comme la façon de faire de la bicyclette. Il est beaucoup plus efficace de simplement montrer à quelqu’un comment faire. C’est ainsi que la formation scientifique se fait dans la pratique. Quand un étudiant fraichement diplômé rejoint mon laboratoire, on peut parfois avoir des discussions philosophiques sur la nature de la science (en général autour d’une bière). Mais il (où elle) apprend à concevoir une méthodologie de recherche par des interactions quotidiennes avec des gens qui font de la science (ce qui donne à penser que faire de la philosophie, ou même se détendre devant une bière, ne sont pas des activités importantes …). Même le raffinement progressif de sa pensée critique au fil du temps n’arrive pas après des cours théoriques sur la façon de penser, mais par un processus long et laborieux de discussions sur des documents de recherches publiés dans la littérature scientifique, ainsi que par la composition de ses propres articles et par la suite la réponse aux critiques reçues d’autres scientifiques.
En d’autres termes, la science s’apprend de la même façon que de nombreuses autres activités humaines complexes, comme la musique, les arts visuels ou en administration des affaires, par l’apprentissage.
Le but ultime de la science est la compréhension des principes généraux qui sous-tendent le fonctionnement de l’univers. Cette compréhension est obtenue par une combinaison de quatre approches:
- L’observation de faits spécifiques ou de phénomènes.
- La formulation de généralisations sur ces phénomènes.
- La production d’hypothèses causales relatives à différents phénomènes.
- Ces hypothèses causales sont ensuite testées par le biais d’observations et autres expérimentation.
La méthode scientifique est basée sur deux solides principes fondamentaux:
- Une explication naturaliste est suffisante pour expliquer le fonctionnement de l’univers.
- L’univers peut être compris par la logique et la pensée rationnelle.
Les scientifiques chevronnés acceptent ces deux types de preuves:
- La confirmation des hypothèses par des données mesurables renforcent leur validité.
- Une incohérence répétée et constante des données lorsque une hypothèse est testée conduit ultimement au rejet de cette dernière.
Il est bon de noter que les scientifiques chevronnés qui travaillent sur une hypothèse prometteuse ne la rejettent pas parce que quelques éléments de preuve ne semblent pas correspondre. En fait, suspendre son jugement sur une où des hypothèses actuellement à l’étude est un outil essentiel dans la science et elle conduit à une compréhension toujours plus sophistiquée des phénomènes. Toutefois, si l’on est convaincu hors de tout doute raisonnable que d’autres explications, peuvent être exclues, l’hypothèse à tester est alors abandonnée au profit d’une alternative plus prometteuse.
En formulant des hypothèses , les scientifiques tentent d’arriver à l’explication la plus simple possible en tenant comptes des données disponibles. Ce principe, connu sous le nom de rasoir d’Occam (ou de parcimonie), équivaut à dire que la science tente de faire le moins d’hypothèses possibles pour expliquer le fonctionnement de notre monde. Si vous n’avez pas besoin d’invoquer une hypothèse particulière, si vous pouvez tout aussi bien expliquer les résultats de façon plus parcimonieuse, il n’y a aucune raison de rendre votre édifice théorique plus lourd que ce qui est strictement nécessaire. Cela ne veut pas dire que notre monde ne peut pas être plus complexe que ce que les scientifiques peuvent imaginer. C’est tout simplement qu’il doit y avoir une bonne raison de penser qu’il est plus complexe, sinon comment décider quelles hypothèses supplémentaires sont justifiées et lesquelles ne le sont pas.
Prenons un exemple pratique: Pour comprendre comment les avions volent, nous avons besoin d’invoquer la loi de la gravité et les principes de l’aérodynamique (entre autres). Nous pourrions aussi faire des hypothèses particulières concernant d’autres principes encore inconnus, comme l’anti-gravité. Mais nous n’avons aucune preuve et donc aucun besoin d’invoquer, l’anti-gravité. Ce qui ne signifie pas que l’anti-gravité n’existe pas. Toutefois, si nous l’invoquons sans aucune raison apparente, alors qu’est-ce qui nous empêche de ne pas aussi se prévaloir d’autres phénomènes hypothétiques, tels que les propriétés particulières des métaux lorsqu’ils sont élevés dans les airs, ou le rôle mystique du champ magnétique terrestre, ou autre chose?
Le fait est qu’il y a un nombre infini d’autres phénomènes potentiels qui pourraient expliquer pourquoi les avions volent. Mais il n’y a aucun moyen de déterminer laquelle de ces solutions envisager, donc les scientifiques choisissent de ne pas les prendre en considération à moins qu’il n’existe une raison impérieuse de le faire. Cela se résume vraiment à du simple bon sens.
Toute production scientifique théorie ou hypothèses qui est confirmée à plusieurs reprises est provisoirement accepté comme valable, en attendant de plus amples données et des tests. Toute théorie ou hypothèse qui a été très largement invalidée par des données empiriques est pour toujours rejetés. Ainsi, par exemple, la théorie que le soleil tourne autour de la Terre n’est plus une théorie scientifique viable, étant donné les preuves accablantes contre elle. La théorie de la relativité d’Einstein est le paradigme dominant de la physique (avec la mécanique quantique), car elle a survécu à de nombreux tests empiriques.
Rien ne dit toutefois, que cela ne pourrait pas changer dans l’avenir. En fait, une jeune et brillante physicienne peut se fixer l’objectif de produire une meilleure théorie que celle de la relativité générale et elle pourrait réussir. Sa nouvelle théorie sera provisoirement considérée comme la meilleure disponible, et ainsi de suite. La science, si vous voulez, est bien davantage à propos du « très probable », mais jamais à propos de la « vérité absolue ». C’est une caractéristique que les scientifiques créationnistes et fondamentalistes trouvent apparemment dérangeante, ce qui explique sans doute les idéologies des deux côtés de la question.
La seule raison pourquoi tous les aspects susmentionnés de la méthode scientifique se justifient, c’est qu’ils fonctionnent. Il n’y a pas d’autre justification externe ou interne de la science à notre disposition. Maintenant, la liste donnée plus tôt dans cette section présente la plupart des aspects de ce que les scientifiques reconnaissent comme étant la méthode scientifique. Toutefois, le mot méthode n’est pas utilisé ici dans le sens d’un plan d’action ou d’une liste d’étapes à suivre, affichée bien en vue dans chaque laboratoire et dont chaque scientifique tient compte en s’y référant constamment comme une liste d’épicerie. Il s’agit simplement d’une explication approximative en termes simples des principes qui régissent l’approche du travail des scientifiques dans leurs processus d’étude de la nature. À un certain point dans chaque entreprise scientifique, chacun de ces aspects devient un principe de fonctionnement, un genre de modus operandi de ce que les scientifiques font réellement. Pensez à une boîte à outils à partir de laquelle différent outils sont utilisés par les scientifiques en fonction de ce qui est nécessaire pour résoudre un problème donné.
La science comme travail de détective
Une façon utile de penser à la science est de constater la similitude frappante entre cette dernière et un détective. Un scientifique n’est pas vraiment si différent d’une version moderne et techniquement sophistiquée du Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Comme Holmes, un scientifique doit évaluer la preuve, qui, parfois, exclut d’emblée certains suspects dans la recherche de solution de l’affaire et dans d’autres cas se concentre fortement sur l’implication d’un responsable en particulier. Comme Sherlock Holmes, le scientifique ne peut jamais être totalement certain de la résolution d’une affaire. Il y a toujours la possibilité qu’un élément de preuve important n’ait pas été trouvée ou a été mal interprétée. C’est vrai en raison de la forte nature analogique du travail scientifique et du travail de détective (bien que déductif il joue un rôle également).
Malheureusement, la nature ne passe pas spontanément aux aveux, mais même Holmes ne serait pas trop compter sur une confession, car une confession peut être obtenue par l’objet de pressions, ou par d’autres moyens illégaux ou peu fiables. Ce qui conduit Holmes à la solution d’une affaire est généralement la convergence de toutes sortes de preuves indépendantes qui pointent toutes vers la même solution.
De même, le scientifique se base sur l’hypothèse très raisonnable qu’il existe un monde extérieur. Si c’est le cas, alors nos observations, expériences et théories ne sont que des fenêtres partielles sur le même paysage sous-jacent. Lorsque plusieurs de ces fenêtres s’ouvrent sur des aperçus comparables et cohérents de cette réalité, nous devenons plus confiants (mais jamais logiquement certains) dans notre connaissance du paysage. Cette convergence de faits disparates comme s’ils indiquaient une seule réalité sous-jacente est parfois appelée la propriété de consilience ou d’unicité (le même mot utilisé dans le livre de E.O. Wilson mentionné plus tôt, mais avec un sens beaucoup plus limité).
Par conséquent, le plus de preuves indépendantes que nous pouvons recueillir, ou le plus d’expériences nous pouvons mener à bien, plus les scientifiques se sentent à l’aise de tirer des conclusions sur un sujet de recherche particulier. Sherlock Holmes souscrirait certainement à une telle approche prudente. Le point important à considérer est que l’application de la science repose sur la possibilité de tester des hypothèses, quel que soit les méthodes employées pour tester ces hypothèses dans un cas donné.
Un autre point tout aussi crucial à comprendre au sujet de la science est que les conclusions des scientifiques sont sans cesse, et pour une période indéterminée, sujet à des révisions par des pairs. En d’autres termes, les scientifiques sont constamment en train de valider les conclusions de leurs collègues, un système scientifique de freins et de contrepoids. C’est ce qu’on appelle le processus d’examen par les pairs, et c’est une partie intégrante de ce qui rend la science si unique en tant qu’entreprise humaine. Cet examen par les pairs est un mécanisme d’autocorrection. La science révise continuellement et met à jour ses propres conclusions (provisoires).
Selon la métaphore proposée par John Casti (dans son livre Paradigmes Lost ) le mécanisme de la science est telle une «botte invisible » qui sert à botter au loin les idées qui ne fonctionnent pas, même si les scientifiques peuvent être moins objectifs ou impartiaux que nous voudrions qu’ils soient. Le résultat final de tout cela est une recherche passionnante pour des explications plus sophistiquées et meilleures de la réalité, une recherche qui jusqu’ici a rencontré un certain succès et est tout simplement inégalée par toute autre méthode déjà essayé (y compris la religion révélée, le mysticisme et la pseudoscience).
Pourquoi la science fonctionne
Ma déclaration antérieure selon laquelle la meilleure raison d’utiliser la méthode scientifique est qu’elle fonctionne peut sembler tout à fait un maillon faible dans l’édifice scientifique et par conséquent, elle mérite un examen plus approfondi. Beaucoup de gens ont tenté de justifier (ou d’attaquer) la méthode scientifique en invoquant toute sorte de motifs, généralement philosophiques. L’idée à la base est que si nous voulons investir une telle somme de travail et d’argent sur un type particulier d’activité, nous devons savoir pourquoi il fonctionne. Cela semble tout à fait raisonnable, sauf qu’il n’y a aucun moyen de savoir pourquoi ça marche parce qu’il n’y a pas de critères externes, d’évaluation indépendante. Personne n’a encore inventé une façon indépendante et fiable de comprendre la réalité, d’une manière qui n’est pas en soi elle-même partie de cette même réalité que nous devons essayer de comprendre (par exemple, il n’existe pas une telle chose que ce que les philosophes appellent le « point de vue de Dieu», disponible à l’homme) .
Ainsi, bien que nous puissions comparer l’efficacité de la science à celle d’autres activités concurrentes, il n’y a pas d’étalon universel que nous pouvons utiliser pour juger de l’efficacité de toute méthode de recherche de la vérité. En fait, il y a de bonnes raisons de penser que l’humanité ne pourra jamais parvenir à ce point de référence universel, parce qu’il nous faudrait développer une connaissance complète du monde pour être en mesure de le faire.
Il est clair, cependant, que les critères d’une pratique émergent de la pratique elle-même. Cela est assez simple et légitime et ces critères auto-générés ne sont pas du tout préjudiciable à la pratique de la science. Au contraire, le développement de critères d’évaluations au sein de la science n’est pas différent de l’élaboration de critères au sein de toute autre pratique, comme cette analogie va le montrer.
Considérons un exemple banal, mais en réalité tout à fait pertinent. La cordonnerie, étant une activité économique compétitive, elle exige des critères d’évaluation. Comment les cordonniers élaborent-ils les critères permettant de juger de la qualité de leur produit par rapport à celle d’autres cordonniers? Ils le font en portant attention à tous les facteurs qu’ils peuvent discerner qui, d’abord, concernent le port de chaussures et ensuite les besoins fondamentaux d’en porter. Les chaussures sont nécessaires pour protéger le pied de nombreux dangers qu’ils rencontrent lors de la marche, les objets tranchants, les surfaces chaudes et les conditions atmosphériques tels que le froid. Et bien sûr, le port de chaussures affecte la mobilité, de sorte qu’ils doivent s’ajuster suffisamment bien pour qu’eux-mêmes ne fassent pas obstacle à la mobilité de celui ou celle qui les portent. Ainsi, les critères pour la fabrication des chaussures se dégagent du processus elle-même de fabrication de chaussures, sur la base de l’expérience des porteurs de chaussures.
Quel que soit les idées, les méthodes et les technologies employées pour produire les chaussures les plus confortables et offrant la meilleure protection (ce qui n’exclue pas les considérations esthétiques) ceux-ci deviennent les critères de base d’évaluation pour juger de la chaussure. De même, quand la science prétend expliquer le monde naturel et résoudre des problèmes pratiques, les besoins d’explication de la technologie, ainsi que les réussites et les échecs rencontrés au cours du processus, eux-mêmes deviennent la base des critères selon lesquels le succès de la science peuvent être jugés. Il ne s’agit pas d’un raisonnement circulaire tordu. Il s’agit simplement d’une méthode rationnelle pour résoudre n’importe quel problème et des gens dans de nombreuses disciplines intellectuelles différentes le font à tous les jours.
Pourquoi, alors, sommes-nous si convaincus que la science est le meilleur outil que nous avons à ce jour pour percer les mystères du monde? Encore une fois, tout simplement parce qu’elle fonctionne mieux dans la pratique que n’importe quelle autre méthode connue de nous. La science peut être jugée par son succès pragmatique (par exemple, son succès à produire des avancées technologiques) et par la pertinence des explications qu’elle donne (un peu comme le succès dans la fabrication des chaussures).
Pour illustrer à l’aide d’une autre discipline, les économistes ont produit une théorie après l’autre pour tenter d’expliquer pourquoi un type d’économie (par exemple, le capitalisme) devrait fonctionner mieux ou pire qu’un autre (par exemple, le communisme). Cependant, il existe de nombreuses façons de construire de tels arguments et l’on peut habilement défendre une solution ou une autre sur le plan théorique seul. En fin de compte, toutes ces discussions sont rendus caduques par le fait que le système qui a le plus de succès économique va perdurer et faire des émules dans plusieurs pays.
Que le communisme soviétique a été une mauvaise théorie peut être difficile à démontrer théoriquement au-delà de tout doute raisonnable. Mais le fait que l’économie soviétique se soit effondrée est une évidence aux yeux de tous (même si cela a pu se produire en raison de facteurs additionnels). Dans le même esprit, il n’y a pas de raison a priori pour laquelle la religion révélée, la pseudoscience, ou le discours philosophique ne pourrait pas avoir le même succès, voire davantage de succès que la science pour comprendre et contrôler le monde naturel. Mais en pratique, ils ont échoués et donc le fardeau de la preuve incombe à ceux qui prétendent que ces disciplines présentent une alternative viable face à la science.
Faits, hypothèses, théories et lois
Une autre étape importante vers la compréhension de la nature de la science est d’éclaircir une source commune de malentendu: les différences entre les faits, les hypothèses , les théories et les lois . Un fait scientifique est une observation, ou le résultat d’une manipulation expérimentale.Bien que des faits peuvent fournir la confirmation ou la réfutation d’une théorie , une simple accumulation de faits ne produit pas automatiquement des connaissances scientifiques.Les faits doivent être interprétés, et cette interprétation est effectuée dans le contexte d’un cadre bien définie, qu’il s’agisse d’une théorie généralement acceptée ou d’une nouvelle théorie en cours d’élaboration.
En tant que tel, les interprétations restent provisoires et sujettes à révision (ce qui signifie que les faits ne sont pas des entitées purement objectives et logiques, une situation que les philosophes de la science appellent la « surcharge de théories » (theory-ladenness) d’observation). Les faits sont en perpétuelle interaction avec les théories , la théorie courante détermine le type d’observations à faire et les expériences à mener (par exemple, quels sont les types de faits à enregistrer).La théorie est à son tour conservée ou abandonnée en raison de la collecte des faits qu’elle a contribué à générer.
Une loi est un énoncé général qui présuppose que certaines suites d’événements seront toujours prévisibles lorsque certaines conditions sont remplies, toutes choses étant égales par ailleurs.Par exemple, la loi de la pesanteur dit que deux corps s’attirent toujours en proportion de leurs masses et en relation inverse du carré de leur distance.Cela ne nous dit pas pourquoi les corps se comportent de cette manière (pour cela, nous avons besoin d’une théorie de la gravité, qui est fourni par la relativité générale d’Einstein, où la gravité est comprise comme une déformation de l’espace-temps).Mais nous n’avons jamais observé une exception à cette règle, et elle est donc codifié comme une loi .
Considérant qu’en biologie, il y a peu ou pas de lois , en physique, elles sont abondantes. Cette différence est peut être due au fait que les systèmes biologiques sont si complexes (comparés à des atomes ou même des planètes et des étoiles) qu’il est impossible d’avoir quelque chose qui se passe toujours exactement dans les mêmes conditions. C’est pourquoi la biologie mathématique tend à être nettement plus axée sur des approximations statistiques que sur le type d’analyse de solutions précises typique de la physique.
Une hypothèse est une construction mentale humaine qui est utilisé pour fournir une explication raisonnable et temporaire d’une explication causale d’un ensemble de faits.L’utilité d’une hypothèse est mesurée par la façon dont on peut prévoir de nouveaux faits qui peuvent être utilisés pour confirmer ou l’infirmer.
Enfin, une théorie est une construction mentale plus complexe, plus vaste et plus mature q’une hypothèse. Elle a également pour but de fournir une explication causale du monde et de prédire son comportement futur, mais les théories couvrent un éventail beaucoup plus large de phénomènes que ne le font de simples hypothèses (en fait, ils comprennent une variété d’hypothèses qui sont ses éléments constitutifs). Par exemple, dans les premiers stades de l’histoire de la physique, les scientifiques émirent l’hypothèse de la présence de l’éther comme moyen par lequel la lumière pourrait voyager parce qu’à l’époque il était inconcevable que quelque chose puisse se déplacer dans l’espace vide. Cette hypothèse a été abandonnée parce que nous avons maintenant une approche plus globale de la théorie de l’électromagnétisme, ce qui explique de nombreuses propriétés de la lumière, y compris le fait qu’elle puisse voyager dans le vide.