Évolution, créationnisme et sciences – avancé – 3
Leçon 3 : Technologie et humanisme
La théorie du dessein intelligent (DI) représente une approche relativement nouvelle du créationnisme devenu populaire au milieu des années 1990. La grande majorité des néocréationistes partisans du dessein intelligent ne croient pas à une jeune terre ou à une interprétation trop littérale de la Bible (voir leçon 2). Bien que le néocréationisme soit toujours mis de l’avant principalement à cause d’un agenda religieux et majoritairement financé par des sources chrétiennes, telles que la Fondation Templeton et le Discovery Institute, le défi intellectuel qu’il pose est suffisamment sophistiqué pour exiger un examen détaillé. Comme nous allons le voir tout de suite, le niveau du débat se déplace du presque ridicule au philosophiquement sophistiqué. Au moins, les théoriciens du DI en donnent pour leur argent aux philosophes (sinon aux scientifiques).
 Un des principaux représentants du DI est William Dembski (photo), philosophe-mathématicien et auteur de The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (L’inférence du Design; l’élimination de la chance par les probabilités) et No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence (Pas de cadeau: Pourquoi la spécification complexe ne peut-elle être acquise sans intelligence). Dans L’inférence du Design Dembski tente de démontrer qu’il doit forcément y avoir un concepteur intelligent derrière les phénomènes naturels tels que l’évolution et l’origine même de l’univers. L’un des arguments favoris de Dembski est que la science moderne, depuis Francis Bacon, a illicitement laissé tomber deux des quatre principaux types de causes aristotéliciennes, principalement l’idée d’une cause finale, ce qui restreint inutilement ses pouvoirs explicatifs. La science est donc incomplète, selon Dembski et la théorie du dessein intelligent permet de résoudre ce triste état de choses, si seulement les vilains évolutionnistes à l’esprit fermé permettent à Dembski et compagnie de faire leur travail. Voyons brièvement ce qu’il y a derrière cette dispute philosophique.
Un des principaux représentants du DI est William Dembski (photo), philosophe-mathématicien et auteur de The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (L’inférence du Design; l’élimination de la chance par les probabilités) et No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence (Pas de cadeau: Pourquoi la spécification complexe ne peut-elle être acquise sans intelligence). Dans L’inférence du Design Dembski tente de démontrer qu’il doit forcément y avoir un concepteur intelligent derrière les phénomènes naturels tels que l’évolution et l’origine même de l’univers. L’un des arguments favoris de Dembski est que la science moderne, depuis Francis Bacon, a illicitement laissé tomber deux des quatre principaux types de causes aristotéliciennes, principalement l’idée d’une cause finale, ce qui restreint inutilement ses pouvoirs explicatifs. La science est donc incomplète, selon Dembski et la théorie du dessein intelligent permet de résoudre ce triste état de choses, si seulement les vilains évolutionnistes à l’esprit fermé permettent à Dembski et compagnie de faire leur travail. Voyons brièvement ce qu’il y a derrière cette dispute philosophique.
Aristote enseignait que l’on peut poser quatre questions fondamentales au sujet de toute chose soit:
- Quelle est sa cause matérielle, de quoi est-elle faite?
- Quelle est sa cause formelle, la forme, le motif ou la structure incorporée dans l’objet ou le phénomène?
- Quelle est sa cause efficiente, c’est-à-dire son créateur ou l’activité produisant le phénomène ou l’objet?
- Quelle est sa cause finale, la fonction ou le but de l’objet que nous étudions?
Par exemple, disons que nous voulons étudier les « causes » du pont de Brooklyn. Sa cause matérielle se compose des matériaux physiques qui sont entrés dans sa construction. Sa cause formelle concerne les plans établis par les ingénieurs, les plans eux-mêmes précédés par l’idée de ce que les ingénieurs voulaient construire, dans ce cas-ci un pont plutôt qu’un gratte-ciel. Les causes efficientes sont le travail des hommes et des machines qui ont réuni les matériaux physiques et les ont mis en place. La cause finale du pont de Brooklyn est la nécessité pour les gens de connecter deux masses de terre séparées par une grande étendue d’eau, leur permettant ainsi de passer d’un côté à l’autre.
Le dessein intelligent et les causes aristotéliciennes
 Dembski soutient que Bacon (photo) et ses disciples ont supprimé à la fois les causes formelles et finales (les prétendus causes téléonomiques, parce qu’ils répondent à la question de savoir pourquoi quelque chose existe, sur la base du concept aristotélicien de telos, c’est-à-dire le but ou objectif, indiqué par sa fonction, afin de libérer la science de la spéculation philosophique pour l’ancrer fermement dans l’observation empirique. Dembski interprète le concept d’Aristote de telos, ou le but, d’une manière qui favorise sa propre croyance en une fin divine. Il ignore l’évolution historique de la méthodologie et de l’épistémologie scientifique afin de préserver ce concept, car elle est une part intégrante de sa vision chrétienne du monde. Cependant, depuis les travaux de Charles Darwin, la manière dont la science est pratiquée et corrélativement, la compréhension de la méthodologie scientifique, a changé de façon importante..
Dembski soutient que Bacon (photo) et ses disciples ont supprimé à la fois les causes formelles et finales (les prétendus causes téléonomiques, parce qu’ils répondent à la question de savoir pourquoi quelque chose existe, sur la base du concept aristotélicien de telos, c’est-à-dire le but ou objectif, indiqué par sa fonction, afin de libérer la science de la spéculation philosophique pour l’ancrer fermement dans l’observation empirique. Dembski interprète le concept d’Aristote de telos, ou le but, d’une manière qui favorise sa propre croyance en une fin divine. Il ignore l’évolution historique de la méthodologie et de l’épistémologie scientifique afin de préserver ce concept, car elle est une part intégrante de sa vision chrétienne du monde. Cependant, depuis les travaux de Charles Darwin, la manière dont la science est pratiquée et corrélativement, la compréhension de la méthodologie scientifique, a changé de façon importante..
Darwin s’attaquait à une question scientifique complexe d’une manière sans précédent, il a reconnu que les organismes vivants sont clairement «conçus», d’une certaine façon, pour survivre et se reproduire dans le monde qu’ils habitent et cependant en tant que scientifique, il a travaillé dans le cadre d’une explication naturaliste de ce design apparent. Le point à retenir est pourquoi il l’a fait? Il l’a fait parce que les explications surnaturelles de l’époque, étaient nettement téléologiques, au sens aristotélicien, le concept ayant été absorbé dans la métaphysique chrétienne jusqu’au 19e siècle pré darwinien, cette pensée scientifique du XIXe siècle, s’est révélé impraticable. Elle ne pouvait tout simplement pas expliquer les données que Darwin et d’autres savants contemporains avaient observées. Darwin avait à construire son explication à partir d’un cadre naturaliste, en l’absence de toute autre explication viable.
Darwin a trouvé la réponse à la question de la conception apparente dans sa célèbre théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle, combinée avec le processus de base d’une mutation génétique, rend possible la conception dans la nature sans la nécessité d’une intervention surnaturelle, la raison en est que la sélection est vraiment aléatoire et a donc une puissance créative (bien que non consciente). Elle est initiée par les mutations particulières qui se produisent et sont ensuite aiguillées par la nature de l’environnement dans lequel ces mutations apparaissent. Cet environnement pourrait bien être celui où ces mutations sont conservées parce qu’elles sont avantageuses, et se multiplient à travers une reproduction favorisée.
Ce que Dembski appelle « design» est en fait le résultat de l’adaptation d’un organisme à la niche écologique particulière qu’il occupe. Cette adaptation est un processus continu. Les créationnistes ne comprennent généralement pas ce point et pensent que la sélection ne peut qu’éliminer les moins aptes, mais la trouvaille de Darwin était que la sélection est aussi un processus cumulatif, analogue à une clé à cliquet – qui peut construire des choses au fil du temps, malgré l’absence d’un plan.
Darwin a rendu possible l’intégration de toutes les causes aristotéliciennes dans le domaine scientifique, en respectant les causes efficientes et finales. Par exemple, si nous devions demander quelles sont les causes des dents d’un tigre dans un cadre darwinien, nous répondrions de la manière suivante; la cause matérielle est assurée par le matériel biologique qui compose les dents, la cause formelle est la génétique et les mécanismes de développement qui font que la structure biologique d’une dent de tigre diffère d’un autre type, la cause efficiente est provoquée par la sélection naturelle, favorisant certaines variantes génétiques des ancêtres du tigre par rapport à leurs concurrents, et la cause finale est assurée par le fait qu’ayant des dents structurées d’une certaine manière, il est plus facile pour un tigre d’attraper sa proie, donc de survivre et de se reproduire. Les seuls « objectifs» de tout être vivant.
Par conséquent, l’apparence de conception et les causes « absentes » de Dembski sont effectivement une partie de la science moderne, au moins chaque fois qu’il y a un besoin d’expliquer une structure ayant une fonction évidente (comme les composantes d’organismes vivants). Toutefois, le « design » d’un organisme qui lui apporte un avantage adaptatif est un avantage conféré après le fait de la sélection naturelle, ce n’est pas l’accomplissement du telos aristotélicien originel, ou le but, orientant le développement de l’organisme. Pour Aristote, le telos est l’essence immuable, immanente, de l’organisme. Dans une perspective darwinienne, contrairement à l’interprétation aristotélicienne favorisée par Dembski, telos devient tout à fait naturel et certainement pas immuable. En fait, l’essence même de l’évolution est le changement plutôt que de l’immuabilité.
Ainsi, les quatre causes aristotéliciennes peuvent s’appliquer dans le domaine de la recherche scientifique, mais avec des différences importantes dans la manière dont les causes efficientes et finales sont comprises, la science n’est donc pas « incomplète» dans le sens philosophique. Que reste-t-il donc de l’argument de Dembski et d’autres partisans du DI ? Tout comme William Paley bien avant eux, ils font l’erreur d’ignorer la distinction entre la conception naturelle et le dessein intelligent , en rejetant la possibilité de la conception naturelle et en concluant que le design doit être, par définition, intelligent.
La complexité irréductible
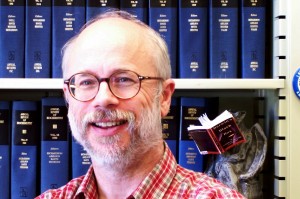 Il y a deux arguments supplémentaires proposés par les théoriciens du DI pour faire la démonstration du dessein intelligent dans l’univers: le concept de complexité irréductible , et le critère de la spécification complexe. La complexité irréductible est un terme introduit dans ce contexte par le biologiste moléculaire Michael Behe (photo) dans son livre « La boite noire de Darwin: le défi biochimique de l’Évolution ». L’idée avancée est que la différence entre un phénomène naturel et une conception intelligente est qu’un objet conçu est planifié à l’avance, avec prévoyance. Même si un intervenant intelligent n’est pas limité par un processus évolutif étape par étape, cette dernière est la seule façon dont la nature puisse procéder, étant donné qu’elle n’a pas la capacité de planification (ce qui peut être désigné comme étant la complexité incrémentale). Donc la complexité irréductible , existe dès lors que toutes les parties d’une structure doivent être présentes et fonctionnelles en même temps pour qu’elle fonctionne, ce qui indique selon Behe, que la structure a été conçue d’abord à ce niveau de complexité et ne peut pas avoir été construite étape par étape par la sélection naturelle.
Il y a deux arguments supplémentaires proposés par les théoriciens du DI pour faire la démonstration du dessein intelligent dans l’univers: le concept de complexité irréductible , et le critère de la spécification complexe. La complexité irréductible est un terme introduit dans ce contexte par le biologiste moléculaire Michael Behe (photo) dans son livre « La boite noire de Darwin: le défi biochimique de l’Évolution ». L’idée avancée est que la différence entre un phénomène naturel et une conception intelligente est qu’un objet conçu est planifié à l’avance, avec prévoyance. Même si un intervenant intelligent n’est pas limité par un processus évolutif étape par étape, cette dernière est la seule façon dont la nature puisse procéder, étant donné qu’elle n’a pas la capacité de planification (ce qui peut être désigné comme étant la complexité incrémentale). Donc la complexité irréductible , existe dès lors que toutes les parties d’une structure doivent être présentes et fonctionnelles en même temps pour qu’elle fonctionne, ce qui indique selon Behe, que la structure a été conçue d’abord à ce niveau de complexité et ne peut pas avoir été construite étape par étape par la sélection naturelle.
L’exemple préféré de Behe d’un objet irréductiblement complexe est une souricière. Si l’on enlève n’importe lequel des éléments minimaux qui rendent le piège fonctionnel, il perdra sa fonction, en outre, un processus naturel ne peut pas produire de souricière, car il ne fonctionnera pas jusqu’à ce que le dernier morceau soit assemblé. On parle donc de prévoyance et par le fait même de conception intelligente. Ce qui est tout à fait exact. Après tout, les souricières achetées dans les quincailleries sont en effet un produit du génie humain et nous savons qu’elles sont conçues de manière intelligente. Mais que dire des structures biologiques? Behe affirme que, bien que l’évolution puisse expliquer une grande partie de la diversité des organismes vivants visibles, elle ne suffit pas à produire de la complexité au niveau moléculaire. La cellule et plusieurs de ses éléments fondamentaux ainsi que les voies biochimiques sont, selon lui, irréductiblement complexes.
Le problème avec cette déclaration, c’est qu’elle est contredite par la littérature disponible d’études comparatives en microbiologie et biologie moléculaire, dont Behe ne tient pas compte, commodément. Par exemple, les généticiens démontrent continuellement que les voies biochimiques sont partiellement redondantes. La redondance est une caractéristique commune des organismes vivants dans laquelle des gènes différents sont impliqués dans de mêmes fonctions ou dans des fonctions se chevauchant partiellement. Bien que cela puisse paraître du gaspillage, les modèles mathématiques montrent que l’évolution par la sélection naturelle doit produire de la redondance moléculaire parce que lorsqu’une nouvelle fonction est nécessaire, elle ne peut être effectuée par un gène qui a déjà une autre fonction, sans compromettre la fonction d’origine.
D’autre part, si le gène est répliqué (par mutation), une copie est libérée des contraintes immédiates et peut lentement diverger de la structure originale, pour éventuellement prendre en charge de nouvelles fonctions. Ce processus conduit à la formation de familles de gènes, ces groupes de gènes indiquent clairement une origine ancestrale unique de séquence d’ADN qui maintenant se diversifie et exécute une variété de fonctions (par exemple, les globines, qui varient selon les protéines permettant la contraction des muscles impliqués dans l’échange d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang). En raison de la redondance, les mutations peuvent remplacer des composantes individuelles de voies biochimiques, sans compromettre la fonction globale, contrairement aux attentes de la complexité irréductible .
Il convient de mentionner que, dans plusieurs cas, les biologistes n’en savent pas assez sur les constituants fondamentaux de la cellule pour pouvoir formuler une hypothèse ou faire la preuve de son évolution progressive. Mais considérer cette absence actuelle de connaissances comme étant une preuve en faveur du DI c’est invoquer l’argument d’ignorance et cela ne constitue en aucun cas une preuve positive de la complexité irréductible . William Paley avançait exactement le même argument pour prétendre qu’il est impossible d’expliquer l’apparition de l’œil par des moyens naturels (voir leçon 2). Pourtant, les biologistes connaissent aujourd’hui plusieurs exemples de formes intermédiaires de l’œil et il est évident que cette structure a évolué de façon indépendante à plusieurs reprises au cours de l’histoire de la vie sur Terre. La réponse à la question classique créationniste, « À quoi sert la moitié d’un œil? C’est beaucoup mieux que pas d’oeil du tout! »
Toutefois, Behe amène un argument légitime à l’égard de la complexité irréductible , mais pas dans le sens qu’il vise. Il est vrai que certaines structures ne peuvent tout simplement pas être expliquées par le processus lent et cumulatif de la sélection naturelle. De la souricière de Behe, à la montre de Paley, au pont de Brooklyn, la complexité irréductible des objets manufacturés est en effet associée à une conception intelligente, par l’homme. Le problème pour la théorie du DI est qu’il n’y a aucune preuve jusqu’à présent, dans la nature, de complexité irréductible chez les organismes vivants.
Le critère de spécification complexe
William Dembski utilise une approche similaire à celle de Behe pour appuyer les revendications créationnistes car il veut lui aussi démontrer que le dessein intelligent est nécessaire pour expliquer la complexité de la nature. Sa proposition, toutefois, est à la fois plus générale et plus boiteuse. Dans son livre « The Design Inférence », il affirme qu’il y a trois types essentiels de phénomènes de la nature: « régulier», « aléatoire », et « conçu » (le dernier dont il accepte sans discussion qu’il soit le produit d’une intelligence).
Un phénomène régulier serait une simple répétition explicable par les lois fondamentales de la physique, par exemple : la rotation de la Terre autour du soleil. Un phénomène aléatoire serait illustré par le lancer d’une pièce. Le design est considéré comme une explication lorsque deux critères sont satisfaits: la complexité et la spécification (que nous examinerons dans un instant).
Il y a plusieurs problèmes avec ce scénario. Tout d’abord, en laissant de côté temporairement la conception, les choix restants ne sont pas limités à la régularité et l’aléatoire. La théorie du chaos et la théorie de la complexité ont établi l’existence de phénomènes d’auto-organisation, des situations où l’ordre apparaît spontanément comme une propriété émergente des interactions complexes entre les parties d’un système. Ce genre de phénomènes, loin d’être uniquement le fruit de l’imagination mathématique telle que Behe (et, fait intéressant, le créationniste jeune-terre Duane Gish) le maintient, sont bien réels.
Par exemple, certains phénomènes météorologiques, tels que les tornades, ne sont ni réguliers ni le fruit du hasard, mais sont le résultat d’un processus d’auto-organisation. En outre, il existe maintenant des preuves de l’auto-organisation précisément dans un des exemples favoris de Behe de la complexité irréductible : l’assemblage des flagelles bactériens.
Mais revenons à la complexité de la spécification et regardons de plus près deux de ces critères fondamentaux, qui auraient été apparemment capables de détecter la présence d’une intelligence (surnaturelle) dans la nature. À la suite d’un des exemples de Dembski, si les chercheurs du SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), avaient reçu un signal très court de l’espace pouvant être interprété comme un code pour trois nombres premiers, ils ne se seraient probablement pas précipités pour publier leurs résultats et annoncer au monde l’existence d’extraterrestres intelligents. La raison en est que, même si un tel signal pouvait être interprété comme étant dû à une sorte d’intelligence, il serait si court que sa présence pourrait tout aussi bien s’expliquer par le hasard.
Si on lui donnait le choix, un scientifique prudent suivrait le principe du rasoir d’Occam et en viendrait à la conclusion que le signal ne constitue pas une preuve suffisante d’une intelligence extraterrestre. Toutefois, toujours selon Dembski, si le signal a été assez long pour encoder, par exemple, tous les nombres premiers compris entre deux et cent-un, les gens du SETI pourraient alors ouvrir le champagne et célébrer toute la nuit. Pourquoi? Puisqu’un tel signal serait trop complexe pour être expliqué par le hasard et serait également déterminable, ce qui signifie qu’il ne serait pas simplement une séquence aléatoire de numéros, mais plutôt un message intelligible.
Le critère de spécification doit être ajouté, car la complexité est en soi une condition nécessaire, mais non suffisante pour la conception. Par exemple, imaginons que le personnel du SETI reçoit une longue séquence de signaux aléatoires. Cette séquence serait très complexe, ce qui signifie qu’il faudrait beaucoup d’informations pour archiver ou pour répéter la séquence (il faudrait aussi savoir où sont les zéros et les uns), mais elle ne serait pas spécifiable, car la séquence n’aurait aucun sens.
Dembski a absolument raison lorsqu’il affirme que de nombreuses activités humaines, comme celles du SETI concernant les enquêtes sur le plagiat ou la détection du cryptage, dépendent de la capacité à détecter une intelligence. Là où il a tort, c’est de supposer un seul type de design: Pour lui, conception équivaut à intelligence et même s’il a admis sur un forum Internet que cette intelligence pourrait bien être une civilisation extraterrestre avancée, sa préférence va à un dieu chrétien.
Le problème est que la sélection naturelle remplit également les critères de spécification complexe, démontrant qu’il est possible d’avoir une conception inintelligente dans la nature. Les organismes vivants sont en effet complexes et sont également spécifiables, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aléatoires, mais plutôt des assemblages assez systématiques de composés organiques, bien formés de façon à améliorer leurs chances de survie et de reproduction dans un environnement changeant et complexe. Qu’est-ce donc qui distingue les organismes vivants du pont de Brooklyn? Les deux répondent au critère de spécification complexe de Dembski, mais seul le pont est irréductiblement complexe. Ce fait a des implications importantes pour la théorie de la conception.
En réponse à certains de ses détracteurs, Dembski prétend que le dessein intelligent ne signifie pas une conception optimale. La critique de la conception suboptimale a souvent été avancée par les évolutionnistes qui se demandent pourquoi Dieu ferait un travail aussi bâclé à la création ou même un simple ingénieur humain peut facilement déterminer où sont les défauts. Par exemple, pourquoi les êtres humains ont-ils des hémorroïdes, des varices, des maux de dos et des douleurs aux pieds? Si l’on suppose que nous étions conçus « intelligemment», alors le créateur est soit incompétent ou alors il a eu un mauvais sens de l’humour, ce qui ne ferait guère plaisir à un créationniste (bien que cela n’est pas semblé déranger Platon, comme nous l’avons vu dans la leçon 2). Au lieu de cela, la théorie de l’évolution propose une réponse unique et simple à toutes ces questions: l’homme a évolué à la bipédie (la marche debout) que très récemment et la sélection naturelle n’a pas encore pleinement adapter notre corps à sa nouvelle condition.
Dembski, bien sûr, a raison de dire que le dessein intelligent ne signifie pas une conception optimale. Autant le pont de Brooklyn est une merveille d’ingénierie, il n’est pas pour autant parfait, ce qui signifie qu’il a dû être construit en respectant les contraintes et les limites du matériel disponible et de la technologie existante, il est encore soumis aux lois naturelles ainsi qu’à la dégradation. La vulnérabilité de la passerelle aux vents violents et aux tremblements de terre et son inaptitude à accommoder un fort volume de circulation pour lequel il n’a pas été construit, peuvent être considérées comme synonyme aux maux de dos causés par notre histoire évolutive récente. Cependant, l’imperfection des organismes vivants, déjà soulignée par Darwin, rend caduque l’idée qu’ils ont été créés par un créateur omnipotent et bienveillant, qui ne se serait sûrement pas limité par les lois de la physique qu’il a créées à partir de rien.
En résumé, il me semble que les arguments principaux des théoriciens de la conception intelligente ne sont ni nouveaux, ni très convaincants:
- Il est faux de prétendre que la science ne répond pas à toutes les causes aristotéliciennes chaque fois que la conception doit être expliquée. La science au contraire satisfait aux causes aristotéliciennes, car elle a englobé et amélioré leurs fonctions, un fait qui démontre qu’Aristote a anticipé de façon importante les explications scientifiques modernes.
- Bien que la complexité irréductible puisse effectivement être un critère valable pour distinguer une conception intelligente d’une non intelligente, il ne s’agit pas des deux seules possibilités, de plus les organismes vivants ne semblent pas être irréductiblement complexes.
- Le critère de complexité de la spécification est en fait expliqué par les effets de la sélection naturelle et ne peut donc fournir un moyen de distinguer entre la conception intelligente et non intelligente.
- Si la conception surnaturelle existe malgré tout (mais où est la preuve ou une logique convaincante?), ce n’est certes pas celle à laquelle la plupart des religionnaires vont souscrire, étant donné les limites évidentes des résultats de cette conception.