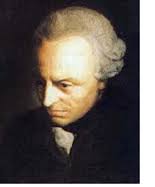Introduction à l’humanisme – 5
Le siècle des lumières
La période dites des « lumières » débuta au 17e siècle et connut son apogée au milieu du 18e. Elle marqua le passage de l’humanité de « l’âge de la foi » vers une période d’émergence du raisonnement, de la science et du respect pour l’être humain en général. Les penseurs des lumières croyaient que le raisonnement humain pouvait amener à la connaissance des lois naturelles de l’univers, déterminer les droits fondamentaux des humains et par conséquent entrainer un réel progrès pour la société par la technologie et par la compréhension du monde qui nous entoure.
Un stimulant majeur pour le siècle des lumières fut les découvertes scientifiques des lois universelles de la nature. Vers la fin des années 1600, grâce aux travaux entre autres de Copernic, Galilée et Newton des lois universelles furent établis en mécaniques (incluant la gravité) et en optiques. Les penseurs des lumières se concentrèrent sur l’accroissement du savoir et l’application de la méthode scientifique au service de l’humanité et de la société.
Même si la critique des dogmes religieux était toujours une entreprise périlleuse. Le scepticisme envers ceux-ci devint plus commun dans l’europe du 18e siècle, en partie grâce au développement d’une vue plus scientifique de l’univers. Le philosophe écossais, David Hume, exprima son scepticisme envers les miracles dans deux livres, la section X de « Enquête sur l’entendement humain » et sur la religion dans « Dialogues sur la religion naturelle » (bien que, prudemment, il s’assura que ces livres soient publiés après sa mort.)
Bien que quelques-unes des figures dominantes des lumières fussent des athées , alors que d’autres étaient chrétiens, la caractéristique la plus commune de la période des lumières fut le déisme . Les déistes croyaient en un « dieu de la nature » qui aurait créé l’univers et s’en serait désintéressé par la suite pour le laisser à lui-même. Le créateur « déiste » ne pouvait déroger aux lois de la nature. Le déisme rejetait donc l’idée d’un dieu intervenant dans les affaires humaines, répondant aux prières et communiquant par le biais de prophètes. Tout comme les anciens philosophes chinois et grecs qui affirmaient qu’on ne pouvait connaitre ni les dieux, ni le surnaturel et donc qu’on ne pouvait fonder une morale sur eux, les déistes croyait que l’éthique et la connaissance devait se fonder sur le raisonnement et les lois naturelles et non sur une révélation divine. Dans les faits il y a effectivement très peu de différences entre les déistes et les humanistes athées
Les philosophes
La pensée des lumières fut défendue par un groupe de philosophes français qui sont devenus célèbres. Le fait d’armes principal de ce groupe d’érudit fut la création de l’encyclopédie. Le premier recueil de la connaissance humaine qui fut compilée entre 1751 et 1765 principalement par Denis Diderot avec l’aide d’autres philosophes tel que D’Alembert, Rousseau, La Mettrie, Helvétius et D’Holbach. L’Encyclopédie reflétait leur scepticisme envers la religion.
Un des penseurs politiques les plus influents des lumières fut Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. C’est Montesquieu qui développa le concept de l’état démocratique avec une « séparation des pouvoirs » appelé à garantir les libertés individuelles. Un autre célèbre philosophes fut Voltaire, célèbre pour ses croisades contre les injustices et sa critique cinglante de la chrétienté.
démocratique avec une « séparation des pouvoirs » appelé à garantir les libertés individuelles. Un autre célèbre philosophes fut Voltaire, célèbre pour ses croisades contre les injustices et sa critique cinglante de la chrétienté.
Les idées de ces philosophes influencèrent la révolution française surtout en ce qui concerne la sécularisation de la société et le républicanisme qui furent repris lors de la déclaration des droits de l’homme en 1789. Malheureusement l’intolérance et les excès de la révolution durant « la terreur » allaient à l’encontre des principes de bases des lumières qui défendaient les droits humains.